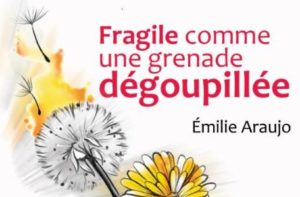Solène a reçu la maquette de son livre pendant l’été, 7 mois après le début de notre accompagnement. L’occasion de faire le bilan d’un accompagnement qui aura permis une rencontre, celle de Solène avec elle-même.
Le bon moment
Pour ce travail de rédaction, 6 h d’entretiens ont « suffi », quand en moyenne une dizaine d’heures sont souvent nécessaires pour parvenir à recueillir le contenu d’une vie. Dans le cas de Solène, cette durée « réduite » s’explique notamment par tout le travail de psychothérapie mené en amont depuis plusieurs années.
Son niveau de conscience de ce que permettrait ou non l’autobiographie restaurative était donc déjà bien aiguisé : « Avant je me trouvais un peu enchaînée à ça. Si je ne peux pas m’en défaire, je peux tout de même apprendre à vivre avec ».
Lorsque Solène me contacte, elle le dit elle-même : « Cela m’a beaucoup aidé à progresser, je me sens plus apaisée avec cette partie de mon passé. Néanmoins, aujourd’hui je ressens le besoin de coucher ces maux sur papier ».
Ce cheminement personnel préalable est à mon sens un prérequis indispensable pour toute personne souhaitant se lancer dans l’écriture d’une autobiographie restaurative. J’y suis en tout cas vigilante et vérifie toujours, avant de démarrer un accompagnement, quelle relation le narrateur entretient avec l’histoire qu’il souhaite écrire et raconter.
Car la temporalité est un facteur clef pour qu’il puisse y avoir restauration. Trop tôt, l’exercice d’écriture ne ferait que raviver le traumatisme et provoquer à nouveau la douleur. Trop tard, tout aura déjà été dit.
Cette temporalité, j’y suis vigilante, et le narrateur aussi. Dans le cas de Solène, comme de beaucoup d’autres, notre rencontre n’est jamais vraiment un hasard. « Je sens que c’est le moment », « je ne veux plus me sentir enchaînée à cette partie de mon histoire ».
Le biographe comme rempart à la peur
Tout ce que le narrateur aura pu mobiliser comme ressources au préalable n’empêche pas les craintes. Celles de Solène étaient d’ailleurs bien présentes au démarrage. « J’ai peur de ce que le processus peut me faire revivre. J’ai peur de redire ces mots ». Elle rajoutera aussi : « Mais j’en ai besoin ».
« Le geste est là, l’envie aussi, malheureusement la peur est également présente. Je ne sais pas comment l’écrire, comment le communiquer. J’ai tenté des essais, mais cela reste un exercice difficile. J’ai commencé, mais il y a comme un blocage. Je ne sais pas comment m’y prendre. »
Il y a la volonté, et il y a l’acte. Comment passer d’un besoin viscéral de dire, d’être compris et reconnu, à une expression construite et à un message élaboré ?
En structurant, petit à petit, la pensée et les écrits. En acceptant qu’au démarrage, tout ne soit pas forcément clair. Qu’il faille tester, modifier, rayer, réessayer, rajouter. Que certains passages soient intégrés plus tard, quand le narrateur se sentira assez en sécurité personnelle et interpersonnelle pour les évoquer…
Le travail de coécriture s’est installé facilement avec Solène. Une fois l’intention posée et le premier jet proposé, Solène s’est rapidement approprié la démarche en intégrant ses propres ajouts. Parfois, ce qui ne pouvait pas être dit a été écrit directement. Et d’autres fois, ce qui était dit n’était pas retranscrit. Le tri s’est fait naturellement au fil des pages et des échanges.
« Je ne pars plus d’une feuille blanche. Je me mets plus facilement dedans, je peux rectifier certaines choses. L’exercice devient plaisant et c’est libérateur d’y mettre ma part. L’écriture permet de remettre les choses dans leur contexte.
Donner la/sa voix
Aux questions systématiquement posées en préambule de toute co-écriture « que souhaitez-vous écrire ? Pour quoi ? Et pour qui ? », là encore, la réponse de Solène a été pensée et réfléchie :
« Ce livre, je l’adresse avant tout à moi, à la petite fille que j’étais au moment des faits. J’aurais aimé tomber sur un livre comme ça, y lire des similitudes, pouvoir me lire en quelqu’un d’autre pour confirmer mon intuition du problème. J’aimerais l’écrire pour cette petite fille, pour lui rendre cette parole qu’elle n’a pas pu prendre à l’époque, et lui laisser enfin la place de s’exprimer ».
Très vite donc, l’idée d’une écriture à deux voix s’est présentée, d’un double regard : celui de Solène, adulte, forte du travail mené en psychothérapie et capable d’aborder cet épisode de sa vie avec recul ; et celui de la Solène enfant, qui pourrait enfin dire, crier, dénoncer tout ce qu’elle a subi.
Dans les deux cas, à travers ces deux voix, le besoin est de dire et de lutter contre la honte.
« C’est mon histoire et aujourd’hui je l’écris parce que je ne veux plus de honte. J’aimerais que ce livre soit aussi un moyen d’expression auprès de mes proches pour qui ce sujet est difficile à aborder, voire tabou, car ils ne savent pas comment y répondre ».
Reprendre parole et donner parole. En autobiographie restaurative, il ne s’agit pas simplement de raconter des faits. L’objectif est aussi de pouvoir donner une place au vécu, de le situer dans un ensemble et ainsi de s’adresser aux acteurs « secondaires » pour rendre possible la discussion et l’échange.
L’objet livre, bien que pertinent dans sa finalité matérielle et symbolique (extérioriser son vécu, pouvoir clore un chapitre pour en entamer un autre…), est également un support pour permettre de créer un espace de parole jusqu’alors interdit ou tabou.
Enfin réunies
Se lire au « je » n’est jamais chose facile. Être le personnage principal d’un récit nous amène à porter un regard distancié sur nous-mêmes et sur la situation, et peut parfois générer une forme de gêne. La première lecture est toujours un moment très particulier en ce sens.
« C’est mon histoire que je lis, pas celle d’une autre. Une fois la première page passée, j’étais très impatiente de découvrir la suite. Désormais, c’est posé, c’est ancré. C’est plus gérable.»
Mais une fois la dynamique lancée, l’espace se crée et la posture s’ancre.
« Je me sens libérée, et la petite fille aussi. J’ai le sentiment d’avoir fait un grand pas en avant, de moi vers moi. L’écriture s’est inscrite dans une suite logique, elle est venue donner un coup de boost, pas toujours facile, mais nécessaire. J’ai l’impression de respirer à nouveau, reprendre un nouveau souffle, comme une forme de renaissance. C’est comme si cette partie de moi était désormais à l’extérieur. Elle n’est plus en moi, mais dans mon livre. Je ne ressens plus de lourdeur. Je suis allégée d’un poids. Notre travail m’a permis de tourner la page. Cette partie de mon histoire est toujours là, mais je peux désormais passer à un autre pan de ma vie et avancer. Je suis en paix avec ça. Ça me fait tellement de bien, beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais ».
Les dernières modifications ont été faites. D’ici quelques semaines, Solène recevra 10 exemplaires de son livre, qu’elle distribuera à ses proches et à sa thérapeute.
Un chapitre se ferme et d’autres restent à écrire. De nouvelles occupations l’attendent, dont un mariage. C’est désormais main dans la main avec la petite fille qu’elle était qu’elle pourra avancer dans la vie, enfin réunies…